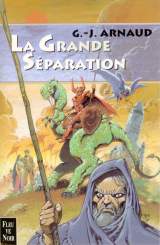À partir du milieu des années 60, l'accroissement progressif des
parutions de la collection Anticipation - qui passe de deux à sept titres
mensuels en l'espace d'une décennie - contraint le Fleuve Noir à recruter
de nouveaux auteurs, déjà connus ou encore inédits, ainsi qu'à inciter des
habitués d'autres collections de la maison à faire leurs premiers pas dans
le domaine de la Science-Fiction. Dans la première catégorie, les noms de
Pierre Barbet, J. & D. le May, Louis Thirion, Jean-Pierre Andrevon -
sous l'incroyable pseudonyme d'Alphonse Brutsche-, Pierre Pelot - qui
signe alors Pierre Suragne -, Paul Béra ou Gilles Thomas viennent
spontanément à l'esprit. Les transfuges du roman policier, d'espionnage ou
d'aventures, eux, s'appellent Pierre Courcel, André Caroff, Jacques Hoven,
Dan Dastier, Christian Mantey, Piet Legay... et G.-J.Arnaud.
Né en 1928 en Camargue d'une famille issue des Corbières, ce dernier a
vingt-trois ans lorsqu'il écrit son premier roman, Ne tirez pas sur
l'inspecteur, qui obtient le Prix du Quai des Orfèvres. Néanmoins, le
succès du Salaire de la peur de son quasi-homonyme contraint
Georges-Jean Arnaud à prendre un pseudonyme, Saint-Gilles, premier d'une
longue lignée de noms d'emprunts. Depuis, il a rédigé plus de quatre cents
romans - soit une moyenne de huit par an, son record en la matière
s'établissant à vingt-sept! Pour plus de détails, le lecteur se
reportera utilement à l'omnibus L'Homme noir, qui comporte une
préface pleine d'enthousiasme de Michel Rossillon, ainsi qu'une
bibliographie, forcément impressionnante, de cette oeuvre titanesque qui
aborde la quasi totalité des genres populaires, du roman noir à
l'érotisme, de l'espionnage au fantastique, de l'aventure à la
Science-Fiction.
Les Chroniques de la Grande Séparation, dont les trois volumes
initiaux sont parus, à raison d'un par an, entre 1971 et 1973, constituent
les premiers pas en Anticipation de l'auteur de La Compagnie des
glaces. Il est clair que celui-ci, qui avoue ne pas être amateur de
Science-Fiction, a cédé à la demande de son éditeur, comme d'autres de ses
collègues cités ci-dessus. Comme eux également, il a l'habitude de passer
sans crier gare d'un genre à l'autre, à la manière des grands auteurs
populaires, mais la transition vers la SF est plus difficile, en raison de
la spécificité de ses outils thématiques et de narration. Certains,
d'ailleurs, s'y cassent les dents; échouant à appréhender l'essence du
genre, ils se cantonnent dans des poncifs qui vont le plus souvent de pair
avec une méconnaissance des faits scientifiques les plus élémentaires.
D'autres s'en tirent par la transposition; c'est par exemple le cas de
Jacques Hoven, dont les meilleurs titres sont ceux où il recourt aux
thèmes et aux techniques du roman colonial ou de la littérature
d'espionnage. Mais G.-J. Arnaud, en dépit de son manque d'intérêt avoué
pour la SF, va d'emblée s'inscrire au coeur du genre - pour en détourner
aussitôt certains clichés.
L'un des principaux thèmes, sinon le thème dominant de la
collection Anticipation a toujours été les relations entre des peuples ne
se trouvant pas sur le même barreau de l'échelle de la civilisation. Quand
ce ne sont pas des extraterrestres super-évolués qui viennent rendre
visite à la Terre - ou tenter de la conquérir -, ce sont nos descendants
qui découvrent des mondes moins avancés sur le plan social et/ou
technique. Et, naturellement, ces rencontres parfois inopinées débouchent
plus souvent qu'à leur tour sur de bonnes vieilles guerres
interstellaires, qui constituent la toile de fond de nombre d'intrigues
quand elles n'en sont pas tout simplement le moteur principal. Certains
auteurs, comme Peter Randa ou Pierre Barbet, se sont pour ainsi dire
spécialisés dans la SF militaire et la résolution brutale des conflits,
tandis que des gens comme B.R. Bruss ou Louis Thirion ont préféré proposer
des solutions plus pacifiques, mais tous sacrifient à cette thématique qui
reste dominante jusqu'à la fin des années70.
Il n'est donc pas étonnant que le spectre d'une guerre flotte à
l'arrière-plan des Chroniques de la Grande Séparation. Seulement,
ce conflit est terminé depuis des siècles au moment où débute le récit, et
l'on n'en voit que les séquelles... Tout se passe comme si G.-J. Arnaud,
considérant ce thème inévitable, choisissait de l'évacuer le plus vite
possible pour pouvoir mettre en avant des préoccupations plus
personnelles: la guerre lointaine qui a coupé la planète Mara du reste de
l'Univers est avant tout un prétexte pour décrire un monde pseudo-médiéval
où la Science est considérée avec un peu plus que de la méfiance. Il
s'agit à l'évidence d'une manifestation du Syndrome Hiroshima, cette
inclination des auteurs de Science-Fiction à mettre en scène des sociétés
post-cataclysmiques obscurantistes par essence. Et il paraît tout aussi
clair que l'on peut voir dans cette tendance une résurgence de la vision
"classique" de la chute de l'Empire romain.
À de marginales exceptions près, le roman historique manque à la
panoplie de G.-J. Arnaud. C'est pourtant dans ce genre qu'il trouve le
moteur des Croisés de Mara, sans doute parce qu'il se sent a
priori plus à l'aise pour créer un Moyen-Âge de fantaisie que pour
inventer de toutes pièces une société future, surtout s'étendant sur un
grand nombre de planètes. On peut supposer que c'est également pour cette
raison que Les Monarques de Bi repose sur une situation de type
colonial, et que la Fédération galactique ne sera décrite qu'à travers
l'un de ses bagnes, le Lazaret 3, tandis que Les Ganéthiens
revient sur Mara pour revisiter le thème initial, avec un changement de
paradigme en guise de prime.
Cette absence de véritable extrapolation sociale - puisque les
schémas sociologiques procèdent de simples transpositions - peut paraître
étonnante de la part de l'auteur de La Compagnie des glaces, et le
fait qu'il fasse ses premières armes dans la Science-Fiction avec les
Chroniques de la Grande Séparation ne suffit pas à
l'expliquer.
À moins de prendre en compte le facteur space opera.
En effet, une proportion considérable des titres publiés entre 1951 et
1971, date de la parution des Croisés de Mara, fait appel, d'une
manière ou d'une autre, au voyage dans l'espace. Même en excluant les
ouvrages où celui-ci n'est qu'un prélude au saut dans le temps ou dans
quelque autre dimension improbable, et les histoires d'invasions
extraterrestres, dans lesquelles les soucoupes volantes ne font
généralement que jaillir du haut des cieux, il reste que la moitié - au
moins - des romans parus pendant les deux premières décennies d'existence
de la collection peuvent être qualifiés de space operas. Il est
également clair que le Fleuve Noir était demandeur de ce type de récit,
qui avait la faveur du public.
Or, si le space opera constitue peut-être le coeur même de la SF,
il est aussi l'un des avatars du genre dont les archétypes sont les plus
difficiles à manier, car ils ont tôt fait de se transformer en clichés.
Les choix opérés par G.-J. Arnaud lors de la conception des Chroniques
de la Grande Séparation semblent indiquer qu'il avait compris cela, et
une bonne partie de sa démarche est guidée par la volonté d'éviter ou de
détourner les figures imposées qui ne lui conviennent pas. Ainsi, le
voyage dans l'espace, quoique participant à la problématique globale,
n'est jamais au centre du récit, mais au contraire escamoté, relégué
entre les intrigues. Tout comme le motif de la guerre, il se
retrouve en toile de fond, réduit au rang d'utilité, d'élément de décor -
ce qui n'empêche pas ces deux thèmes de participer à la création d'un
cadre familier à l'habitué de la collection.
Néanmoins, en faisant passer le voyage dans l'espace au second plan -
celui d'une commodité -, G.-J. Arnaud se prive de la possibilité de mettre
sur pied une société galactique cohérente. Toute civilisation dépend des
communications, l'expression est bien connue. Si l'univers de La
Compagnie des glaces fonctionne si bien, c'est - entre autres - parce
que l'extrapolation des communications y est particulièrement soignée -
alors qu'elle est réduite à sa plus simple expression dans les
Chroniques de la Grande Séparation, où la Fédération est condamnée
à demeurer une vague entité politique, une de ces constructions partielles
dont le lecteur comble instinctivement les parties manquantes. À ce titre,
elle prend valeur de symbole, et ce qui pouvait passer pour une faiblesse
à première vue se révèle un avantage considérable. Plutôt que l'Empire
lui-même, étudions ses marches, semble se dire G.-J. Arnaud, qui n'a sans
doute pas oublié la leçon du roman noir, où les sociétés se dévoilent le
plus souvent à travers leurs bas-fonds, leurs déviances, leurs marginaux.
Lazaret 3 est, à ce titre, exemplaire, avec sa faune cosmopolite et
interlope, reflet déformé d'une civilisation qui demeure à jamais
inaccessible.
Plutôt que la guerre, montrons ses conséquences. Montrons les mondes
relégués aux marches de la civilisation. Montrons Mara qui a souffert plus
que toute autre planète de ce conflit- et qui continue à en souffrir,
puisque le temps y passe dix fois plus vite que dans le reste de
l'Univers. Montrons le monde colonial figé des Monarques de Bi. Montrons
un bagne spatial et ses pensionnaires.
Laur et ses compagnons sont en quête de la Terre, mais jamais ils ne
l'atteindront car c'est sur Mara que se trouve leur destin. C'est là-bas
qu'on a besoin d'eux, pas sur une mythique planète originelle impossible à
localiser. Ce renoncement à leur quête, tout symbolique qu'il puisse
paraître lui aussi, a peut-être tout bonnement été motivé par le désir de
mettre un terme à la série. Il est vrai qu'en un sens, Lazaret 3
donne un peu l'impression de tourner à vide du point de vue de l'intrigue,
mais son intérêt est ailleurs, dans l'ambiance empreinte de tristesse et
de nostalgie, dans les descriptions truculentes et colorées, dans
l'absurdité de cet univers carcéral- toutes qualités que l'on retrouve
quelques années plus tard dans La Compagnie des glaces. Avec ce
roman, G.-J. Arnaud tenait déjà tout l'aspect émotionnel de la série, mais
il lui manquait encore le cadre approprié; la glaciation et le chemin de
fer le lui ont fourni. On peut même parler de filiation directe, car il ne
s'écoule que six ans entre la parution de Lazaret 3 et celle du
premier volume de La Compagnie des glaces.
Durant cette période, G.-J. Arnaud n'est pas simplement passé d'un
monde clos à un autre, d'un satellite pénitentiaire aux trains d'une Terre
plongée dans l'obscurité; il a en a profité pour explorer, dans des romans
policiers comme L'Homme noir ou La Maison-piège, d'autres
facettes de ce thème - qu'il poussera à bout au début des années 80 avec
ce chef-d'oeuvre d'enfermement littéraire qu'est Bunker-parano. Dans
tous ces livres, et dans bien d'autres du même auteur, de La Dalle aux
maudits au Festin séculaire en passant par L'Enfer du décor,
la délimitation de l'espace joue un rôle primordial. Circonscrit à une
maison, à un village, le huis-clos impose sa dynamique à tous ces
ouvrages, dont la logique exige une solution interne. Le monde
extérieur demeure vague et lointain, il n'exerce aucune influence réelle
sur le déroulement de l'intrigue.
Le parallèle avec Lazaret 3 est saisissant. Nous sommes dans un
cas de figure où le microcosme, reflet déformé de l'univers qui l'entoure,
a fini par phagocyter celui-ci - ou plutôt par le rejeter hors du roman
lui-même. Le satellite pénitentiaire possède la même valeur symbolique que
le pâté de maisons de L'Homme noir ou le hameau de L'Enfer du
décor, et c'est faute d'avoir trouvé une solution réellement interne
que Laur repart sur Mara pour qu'on l'y "reconnaisse comme dieu".
Candide revient cultiver son jardin.
Ce retour aux sources a également pour effet de refermer le huis-clos
plus vaste que constitue la trilogie originelle, un huis-clos composé de
trois systèmes fermés - Mara, Bi et le Lazaret - insignifiants en
comparaison de l'immense et inaccessible civilisation galactique. La
décision finale de Laur est une acceptation de la logique de son monde
natal, cette même logique qu'il a fuie à bord de l'Ogive à la fin
du premier tome. Le huis-clos se referme, mais il est avant tout mental,
tout comme dans les romans noirs ou fantastiques cités plus haut. Il n'y a
pas de murs plus solides que ceux que l'on érige à l'intérieur de son
esprit, semble dire G.-J.Arnaud - une idée qui constituera l'un des thèmes
majeurs de La Compagnie des glaces.
Les Ganéthiens, écrit plus de vingt-cinq ans après Lazaret
3, peut être lui aussi qualifié de huis-clos planétaire. La solution
extérieure que pourrait représenter Laur aidé de la formidable puissance
technologique de l'Ogive est en effet éliminée d'une manière qui
montre bien que, durant tout le roman, le lecteur a eu affaire à deux
systèmes fermés: d'un côté, les passagers du vaisseau spatial; de l'autre,
la population de Mara. Cobo et le Stomk sont les seuls à interagir avec
les deux groupes, mais leurs rapports sont faussés à la base par le double
décalage temporel dont ils sont victimes- et dont leur transparence
représente un symbole élégant. Le fait que ce soit le second qui enlève le
premier dans les dernières pages pour l'emmener à bord de l'Ogive
paraît d'ailleurs indiquer qu'ils forment à eux deux un troisième
système, dont la logique n'est ni celle de Laur, ni celle des
Marayens. Ils constituent, à ce titre, les véritables héros de cet opus
final, ce dont témoigne la place qui leur y est accordée. En un sens, ils
constituent même un genre de solution extérieure, mais uniquement au
problème fondamental de Laur et de ses compagnons, qui vont enfin voir la
Terre. Sur Mara, ils ne parviennent qu'à semer un désordre insensé, et la
barrière entre pensée rationnelle et pensée mythique risque d'en sortir un
peu plus renforcée.
Voilà une planète qui n'est pas près de s'en sortir. Le huis-clos se
referme, mais quelques personnes ont pu échapper entre-temps à son
implacable logique. Le destin de Laur n'est pas sur ce monde qu'il ne
reconnaît plus car trop d'années locales ont passé pendant son absence -
et, de toute manière, il n'a plus envie d'être un dieu. La quête est
ranimée, et la déclaration finale de Cobo semble indiquer qu'elle
aboutira, cette fois. Quant à Mara, elle suivra sa voie, et finira
peut-être par s'en sortir, tout comme la Terre de La Compagnie des
glaces.
Cette conclusion a posteriori constitue à l'évidence un refus du
messianisme, du mythe de l'homme providentiel. Il est vrai que G.-J.
Arnaud a abondamment traité ce thème par ailleurs, dans son autre cycle de
SF. Alors, plutôt que de risquer la redondance, et peut-être aussi parce
que l'idée de Laur divinisé régnant sur Mara lui paraissait trop simpliste
après la folle complexité de La Compagnie des glaces, il a choisi
de saborder le dénouement socio-mystique que suggérait la fin ouverte de
Lazaret3. Et, au bout du compte, c'est bien la logique du space
opera qui resurgit inopinément: non seulement le voyage a changé le
voyageur, mais l'un des rôles principaux est dévolu à un gros oiseau
extraterrestre au caractère pour le moins désagréable.
Des quatre romans composant Les Chroniques de la Grande
Séparation, Les Ganéthiens, écrit après la mort de la
collection qui a déterminé les autres, est celui qui traite de la manière
la plus directe le thème dominant évoqué plus haut: les contacts entre
peuples dits primitifs et civilisations soi-disant évoluées. Les Marayens,
pour la plupart, vivent les événements décrits de la même façon que les
habitants de Sodome et de Gomorrhe ont vécu- du moins, dans certains
titres d'Anticipation - la destruction de leurs villes par des navires
extraterrestres: comme des manifestations d'origine divine. Néanmoins, ce
qui se passe à bord des ovnis n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on
serait en droit d'attendre, et la dimension tragique qui existait dans les
romans précédents s'efface au profit d'une farce noire, où l'indécision
des occupants de l'Ogive va de pair avec l'aveuglement de certains
responsables marayens. Toute cette agitation est bien vaine, puisqu'il n'y
aura pas de messie.
André Ruellan dit que, lorsqu'on se repenche sur quelque chose en quoi
l'on avait cru, on l'aborde généralement sous l'angle de l'humour. Même si
Les Ganéthiens n'est pas à proprement parler un livre désopilant,
il est clair qu'il tire sa force d'une certaine distanciation face à une
situation qui, comme on l'a vu, s'enferme dans une spirale d'absurdité. Il
y a bel et bien eu changement de paradigme, et l'on peut reconstituer
cette évolution, tant dans les nombreux huis-clos qui parsèment l'oeuvre de
G.-J. Arnaud qu'au fil de l'évolution des multiples intrigues de La
Compagnie des Glaces. Logiquement, le sens lui-même des Chroniques
de la Grande Séparation en est lui aussi modifié. Le messianisme, même
éclairé, n'apparaît plus comme une solution. Ce n'est pas d'un dieu que
Mara a besoin, et Laur n'a plus rien à y faire. Ayant rompu ses dernières
attaches avec son monde natal, il peut espérer atteindre la Terre.
Enfin.
Le Loup pendu, 4 novembre 1999.
|